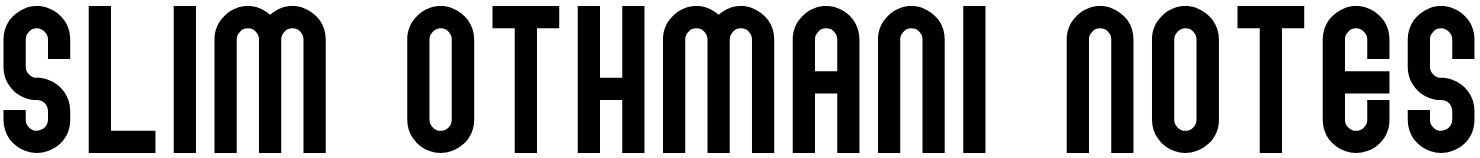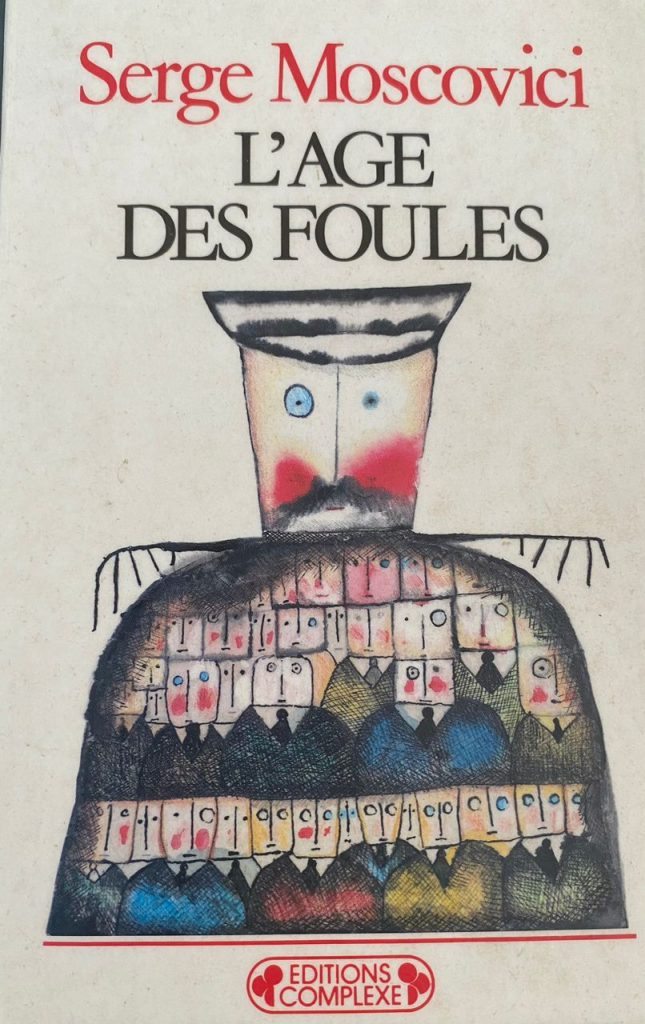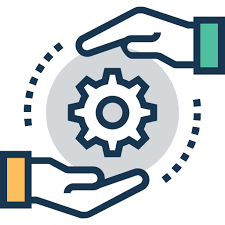“sortir de l’illusion sans entrer dans la soumission”
Nous avons longtemps cru que la souveraineté numérique suivrait les lois anciennes de la souveraineté politique : posséder ses infrastructures, contrôler son territoire, décider seul.
Cette vision se fissure désormais sous nos yeux.
Les géants technologiques ont construit, en moins de vingt ans, une infrastructure mondiale dont l’échelle financière dépasse celle de nombreux États. Cloud, intelligence artificielle, messageries, réseaux sociaux, identités, paiements : autant de couches devenues essentielles au fonctionnement quotidien des économies et des sociétés. Reproduire cet édifice à l’échelle nationale relève, pour la plupart des pays, non d’un choix politique mais d’une impossibilité arithmétique.
Le souverainisme numérique intégral apparaît ainsi comme une illusion.
Mais l’illusion inverse — celle d’une soumission inévitable — l’est tout autant.
Cette dépendance n’est d’ailleurs plus théorique. Elle est devenue visible lorsque, au cœur de tensions géopolitiques récentes, l’hypothèse même d’un débranchement unilatéral de certaines infrastructures ou plateformes numériques a été publiquement évoquée par l’ancien président américain Donald Trump.
Peu importe ici la faisabilité réelle d’une telle décision. L’essentiel est ailleurs : le simple fait que cette menace puisse être formulée révèle une mutation historique.
Pour la première fois, la continuité numérique de sociétés entières apparaît liée non seulement à des choix économiques privés, mais aussi à des rapports de force politiques internationaux.
L’infrastructure technique du monde devient ainsi un instrument potentiel de puissance.
C’est précisément cette prise de conscience qui rend caduques deux illusions opposées :
celle d’une souveraineté nationale totale, devenue hors d’atteinte financièrement,
et celle d’une neutralité permanente des infrastructures privées, désormais insoutenable politiquement.
Entre ces deux impasses émerge une troisième voie.
La souveraineté ne disparaît pas : elle change de nature.
Hier, elle reposait sur la propriété des infrastructures.
Demain, elle reposera sur la maîtrise des conditions d’usage.
Être souverain ne signifiera plus tout posséder, mais pouvoir :
- circuler entre les systèmes sans enfermement,
- protéger les couches critiques de confiance,
- négocier collectivement les règles du jeu,
- et surtout sortir sans rupture d’une dépendance devenue excessive.
La clé n’est donc pas la reconstruction intégrale, mais l’architecture de trois principes simples :
Interopérabilité, pour empêcher le verrouillage.
Réversibilité, pour rendre la dépendance supportable.
Souveraineté sélective, concentrée sur l’identité numérique, les paiements, la cryptographie, les données sensibles et les services publics essentiels.
Dans ce cadre, l’idée d’exiger des garanties de continuité de service aux plateformes systémiques ne relève plus d’une utopie politique mondiale. Elle rejoint une logique prudentielle comparable à celle imposée aux
banques ou aux assurances : fonds de garantie, obligations de préavis, assistance à la migration, responsabilité financière en cas de rupture injustifiée.
La contrainte devient technique et juridique, non idéologique.
Nous entrons ainsi dans une ère nouvelle : celle d’une souveraineté architecturale.
Une souveraineté qui n’érige plus des murs impossibles, mais construit des issues réelles.
Une souveraineté qui accepte l’infrastructure mondiale tout en refusant la dépendance irréversible.
Une souveraineté, enfin, qui ne promet plus l’autonomie totale, mais garantit l’essentiel : la liberté de choix, de sortie et de protection du commun.
Nous ne redeviendrons pas souverains en reconstruisant seuls le monde numérique.
Nous le redeviendrons en imposant les règles qui empêchent qu’il se referme sur nous.
La souveraineté du XXIᵉ siècle ne sera ni un territoire, ni un mur.
Elle sera une architecture de liberté.