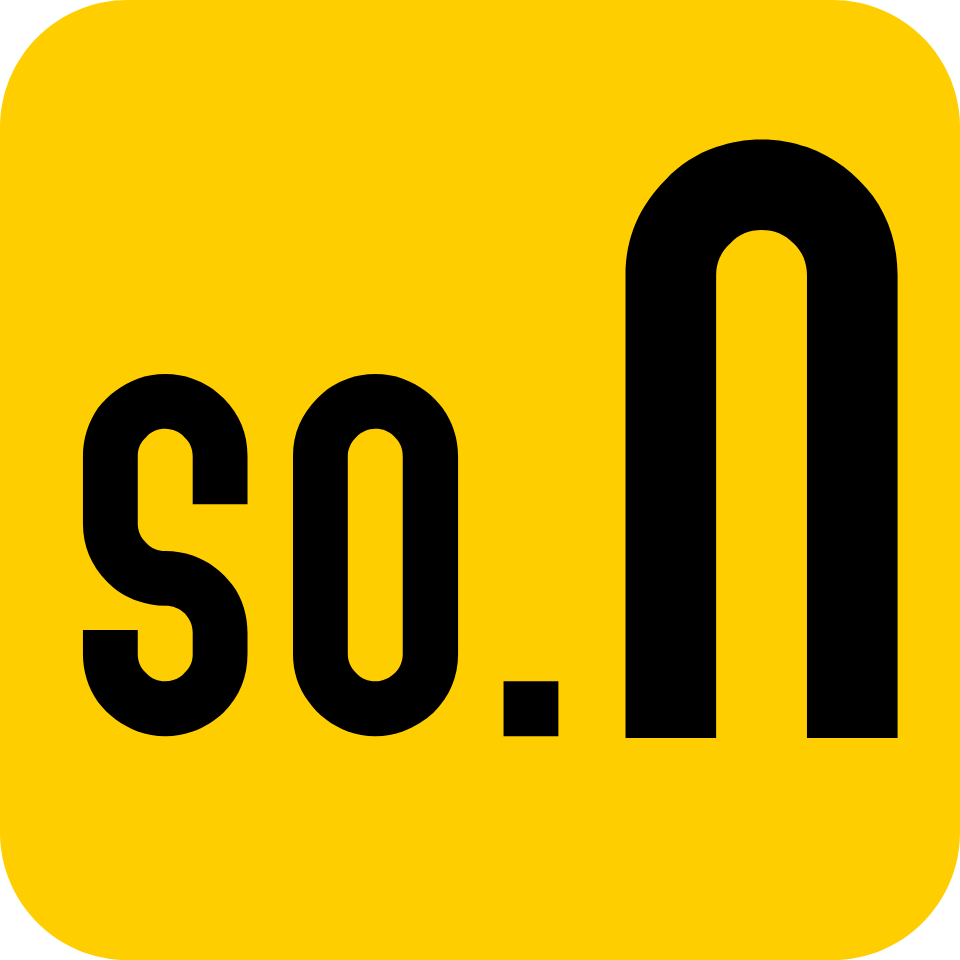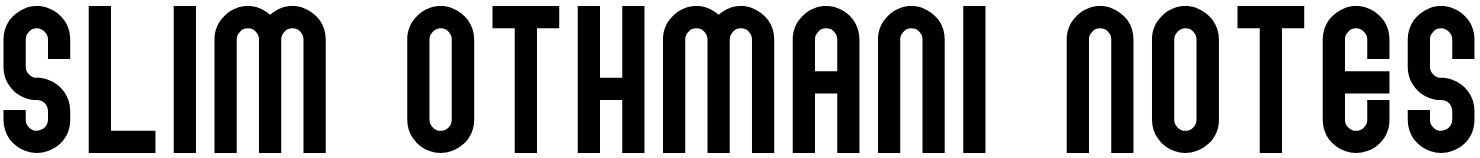Est ce le monde qui change ou juste moi ?
Depuis quelques années, chaque fois que je me retrouve en boîte ou en soirée, la même impression me traverse : les personnes présentes, jeunes pour l’essentiel, dansent sur des musiques sans paroles. Des morceaux hypnotiques, souvent beaux d’ailleurs, mais où aucun mot ne semble avoir sa place. Juste des sons, des pulsations, des montées et des chutes. Rien à chanter, rien à reprendre ensemble. Seulement des corps qui vibrent à l’unisson.
Les mots divisent, le son rassemble.
Cette observation m’est revenue avec force lors d’une discussion avec un ami dont le fils est producteur de musique. En écoutant ce dernier me parler de ses projets, je me suis surpris à lui demander :
« Mais pourquoi vos morceaux n’ont-ils plus de paroles ? »
Il a souri, sans ironie, comme si la question appartenait à un autre temps. Puis il m’a répondu calmement :
« Parce qu’on veut faire ressentir, pas faire réfléchir. Les mots divisent, le son rassemble. »
Cette phrase m’a accompagné longtemps. Quelle magnifique illustration de mon ressenti que cette séquence mythique, prise lors du fameux concert de Burning Man de 2019. Tout y est : la musique, la distance entre les corps qui se déhanchent chacun librement, sans chercher une quelconque harmonie ou complicité avec les voisins de piste. Le fameux chacun pour soi, dans sa pleine expression silencieuse.
Un ancrage émotionnel sans repères
Le mot, c’était aussi le lien, la possibilité de nommer ce que nous ressentons, de donner forme à nos amours, nos douleurs, à nos révoltes, à nos rêves. Sans lui, la musique risque de devenir un courant d’air émotionnel : intense et sans mémoire.
Car comment bâtir un ancrage émotionnel avec une musique sans titre, sans paroles, sans interprète ? À moins d’avoir une oreille musicale exceptionnelle, il n’en reste souvent qu’un écho indistinct, une séquence rythmique perdue dans le flot. Nous sommes bien loin de l’exercice de mémoire qu’exigeaient les anciennes compositions.
Retour à la transe originelle
Alors non, je ne juge pas. J’observe. Peut-être que ces musiques sans paroles disent autre chose : un besoin d’universalité, de se retrouver au-delà des langues, des frontières, des opinions. Peut-être qu’elles annoncent un retour au tribal, au corps, à la transe originelle — comme un cycle qui se referme.
Vibrations partagées
Après tout, l’humanité a commencé par se regarder en silence, puis par émettre des grognements puis des sons qu’elle a fini par assembler pour former des mots.
Elle semble aujourd’hui faire le chemin inverse : se débarrasser des mots pour revenir à l’état extatique, à cette forme première d’union où le langage n’existait pas encore — seulement la vibration partagée. Et c’est peut-être là, au fond, la plus troublante des mélodies.
Le “je” l’emporte sur le “nous”
Je repense souvent aux générations précédentes, celles qui ont grandi avec des chansons à texte, parfois maladroites mais pleines de conviction. Des artistes comme Curtis Mayfield, Fela Kuti, Léo Ferré, Bob Dylan, Bob Marley, John Lennon, Marvin Gaye ou plus près de nous Matoub Lounes ou Cheb Hasni, et bien d’autres, ont mis des mots sur de l’amour, des colères, des espérances, des blessures. Ils parlaient à un “nous”. Ils invitaient à réfléchir, à rêver, à se révolter. Aujourd’hui, ce “nous” semble s’être dissous dans un grand “je” collectif, un peu solitaire mais connecté en permanence.
La Musique un révélateur de notre monde
Cette musique et les danses qui l’accompagnent disent peut-être plus qu’il n’y paraît. Elles disent quelque chose d’un monde où le verbe s’efface, où l’on préfère ressentir plutôt que comprendre, où la communion passe par la vibration plutôt que par le sens. Ce n’est pas un jugement, seulement une interrogation : qu’est-ce que cela révèle de nous et de notre monde actuel ?
Vaincre le bruit du langage
Peut-être que c’est cela, au fond : la musique sans paroles est devenue la bande-son d’un monde saturé de mots. Nous vivons entourés de phrases : notifications, slogans, posts, opinions… Le verbe est devenu envahissant. Alors la musique, pour continuer d’exister, a choisi une autre voie : celle du rythme pur, de l’émotion brute, débarrassée de tout discours. Un refuge contre le bruit du langage.
Carpediem
Indépendamment de mon âge et de mon amour pour la musique, j’avoue n’avoir jamais su, ni vraiment compris, comment lâcher prise comme le font certains en écoutant ces nouvelles musiques dont j’apprécie pourtant la rythmique. Peut-être qu’elles réclament une autre écoute, une autre forme d’abandon, une façon de se fondre dans le son sans chercher à en tirer du sens.
Mais je me demande tout de même ce que nous perdons dans cette mutation.
Étiquette de co-création éthique Humain/IA
| Critère | Contribution Humaine | Contribution IA | Commentaires |
| 1. Idée & angle | 90 % | 10 % | L’observation et la réflexion viennent entièrement de toi ; j’ai seulement aidé à structurer le fil narratif. |
| 2. Recherche & références | 70 % | 30 % | Tu as apporté toutes les références culturelles et historiques ; j’ai seulement proposé quelques harmonisations. |
| 3. Structure & narration | 60 % | 40 % | Ta version est structurée naturellement, j’ai contribué à la fluidité et à quelques transitions. |
| 4. Style & ton | 85 % | 15 % | Ton exigence d’humilité et ton écriture claire dominent nettement. |
| 5. Langue & grammaire | 40 % | 60 % | Ajustements syntaxiques, ponctuation, et cohérence linguistique assurés ici. |
| 6. Profondeur & cohérence | 80 % | 20 % | Ta conclusion anthropologique donne la profondeur et la cohérence de l’ensemble. |
| 7. Originalité & résonance | 90 % | 10 % | Sujet rare, angle personnel et sincère. |
| 8. Potentiel éthique & culturel | 85 % | 15 % | Questionner sans juger : une posture profondément humaine. |
Bilan global estimatif : 75 % Humain / 25 % IA
(Co-création sincère, à dominante humaine)
“Cette étiquette vise à rendre visible la part respective de l’humain et de l’intelligence artificielle dans le processus créatif, sans hiérarchie ni automatisme.”