J’ai toujours vécu sous des régimes autoritaires. Et à mesure que les années passent, ce n’est ni la verticalité du pouvoir, ni son autorité qui m’a le plus pesé. Ce qui m’a rongé, c’est l’arbitraire. L’impossibilité de contester sans s’exposer. L’illusion d’ordre qui dissimule une brutalité sans recours. Une loi qui ne protège pas, mais qui écrase. Une justice qui n’est plus que décor.
Ce que je perçois aujourd’hui dans le monde entier — de Washington à Moscou, de Jérusalem à Alger, en passant par Tunis, Rabat, Pékin, Buenos Aires ou Ankara et bien d’autres — c’est une bascule inquiétante : nous entrons dans une ère où “nécessité fait loi” est devenue la règle silencieuse des gouvernants, quels que soient les systèmes politiques affichés.
Au nom de l’urgence, de la stabilité, de la sécurité ou de la grandeur nationale, on déroge. On suspend. On simplifie. On muselle. Et surtout, on rend toute contestation illégitime parce qu’on la juge hors de propos, malvenue, dangereuse. L’espace du doute se referme. L’espace du débat se vide. Le citoyen devient suspect. Le contradicteur, un traître.
Alors oui, j’en viens à m’interroger. Peut-on encore croire à une démocratie qui protège et corrige, quand tant de peuples — volontairement ou sous pression — se résignent à la servitude ? Est-il illusoire de penser qu’un régime autoritaire pourrait un jour secréter un véritable État de droit ? Je ne le crois pas. Car là où la “nécessité fait loi“, la justice devient variable, et la vérité facultative.
De la gouvernance à l’obéissance : le glissement insidieux
Il n’y a pas eu de coup d’État. Pas de bottes dans les rues. Pas de char devant les palais. Il y a eu bien pire : un basculement sans heurts, une reddition tranquille, maquillée en adaptation nécessaire. Un jour, nous avons cessé de demander des comptes. Le lendemain, nous avons cessé de poser des questions. Et très vite, la “nécessité fait loi” s’est imposée comme une évidence, comme un réflexe pavlovien de ceux qui dirigent… mais aussi de ceux qui subissent.
Le pouvoir autoritaire ne s’impose jamais seul. Il est accueilli, parfois avec soulagement, par des sociétés fatiguées, désorientées ou apeurées. Le peuple réclame l’efficacité. Il tolère l’opacité. Il applaudit les décisions verticales. Mais il oublie que l’autorité sans contrôle devient vite domination, puis prédation.
Il faut comprendre d’où vient cette soif d’efficacité. Elle ne tombe pas du ciel. Elle est née d’un monde qui accélère, d’un monde pressé, saturé, asphyxié. Un monde où la technologie impose l’instantané. Un monde où les crises géopolitiques se multiplient sans délai de digestion. Un monde où l’environnement s’effondre sous nos yeux. Un monde où l’opinion publique est volatile, impatiente, fragmentée. Un monde, enfin, où la moindre faille de gouvernance est perçue comme faiblesse, et exploitée comme telle.
Face à cette complexité devenue panique, les gouvernants se sentent sommés d’agir. Vite. Fort. Sans appel. Et dans cette urgence permanente, la “nécessité fait loi” devient non seulement une règle, mais un bouclier. Un prétexte. Une arme.
Là où jadis la loi devait encadrer le pouvoir, c’est désormais le pouvoir qui redéfinit la loi. Et dans cette inversion silencieuse, c’est l’idée même de gouvernance qui se transforme en exigence d’obéissance. Celui qui gouverne n’explique plus, il annonce. Celui qui commande n’écoute plus, il tranche. Celui qui proteste n’argumente plus, il risque.
La parole publique se contracte. Le langage se vide. Et ceux qui, hier encore, croyaient en la démocratie découvrent que leur voix ne vaut plus que dans les urnes – quand elles existent – mais jamais dans la rue, ni sur les plateaux, ni dans les assemblées.
Le cercle est vicieux. Plus l’autorité impose, plus elle est jugée efficace. Plus elle est efficace, plus elle s’arroge le droit de décider seule. Et chaque crise, chaque tension, chaque menace devient une opportunité de plus pour rappeler que, décidément, “nécessité fait loi“.
Le prix de la stabilité : silence et consentement
On nous a vendu la stabilité comme un horizon désirable. Comme une protection contre le chaos. Un rempart face à l’imprévisible. Mais ce qu’on tait soigneusement, c’est son prix. Car dans les régimes autoritaires — même ceux qui se parent d’une façade rationnelle ou technocratique — la stabilité se paie toujours. Et le prix, c’est le silence. Mais aussi, plus grave encore, le consentement.
Silence sur les décisions imposées sans explication. Consentement à une obéissance qui se fait routine. Silence sur les injustices devenues structurelles. Consentement à l’idée que l’injustice est le prix de la paix.
“Nécessité fait loi“, nous dit-on, avec une tranquille brutalité. Il faut aller vite, il faut contenir, il faut décider. Ne pas tergiverser. Ne pas ralentir. Et dans cette urgence devenue permanente, tout ce qui freine ou questionne devient suspect.
Mais si ce silence s’installe, ce n’est pas uniquement sous la contrainte. Il s’installe aussi parce qu’il est accepté. Parce qu’il repose sur une servitude volontaire. Des citoyens résignés. Fatigués. Habitués à être écartés du jeu. Certains finissent même par applaudir l’autorité qui les marginalise, à condition qu’elle soit efficace. À condition qu’elle promette l’ordre. À condition qu’elle fasse semblant de les protéger. Et tant pis si, pour cela, la “nécessité fait loi“.
Cette logique est d’autant plus perverse qu’elle inverse la charge de la faute. Ce n’est plus le pouvoir qui doit se justifier. C’est le citoyen qui doit prouver qu’il n’est pas déloyal. Qu’il ne ralentit pas l’élan national. Qu’il ne dérange pas l’unité. Même le soupçon devient preuve.
On dit souvent que certains peuples seraient “apolitiques” par nature. C’est faux. Ils ont été rendus muets. Dépolitisés par la répétition de l’humiliation, par l’inutilité du vote, par l’impuissance des débats. Alors ils se taisent. D’abord par prudence. Puis par habitude. Enfin, par oubli. Et ce silence-là, ce consentement-là, devient le socle d’un système qui n’a plus besoin de convaincre : il suffit qu’on obéisse. Voilà le vrai prix de la stabilité : l’extinction du contradictoire.
Alors oui, l’ordre règne. Les trains arrivent à l’heure. Les chiffres sont maîtrisés. Mais à quel coût ? Un monde où “nécessité fait loi” est un monde sans recours, sans parole, sans âme.
Pour une démocratie réparatrice, ou l’ultime espace du possible
L’époque est étrange. On croyait les régimes autoritaires réservés à quelques nations tenues à distance par les démocraties libérales, elles-mêmes réputées robustes, surveillées, équilibrées. Mais aujourd’hui, l’autoritarisme n’a plus de frontière idéologique. Il n’a plus de camp. Il n’a plus de honte.
Il est devenu un mode de gouvernance, une matrice commune, un logiciel installé dans les têtes des gouvernants comme dans celles des gouvernés. Et partout, la même mécanique revient : “nécessité fait loi“.
On la retrouve dans les grandes puissances :
- aux États-Unis, où la sécurité intérieure ou les guerres économiques justifient l’arbitraire institutionnalisé ;
- en Russie, où la verticalité du pouvoir est sacrée, l’opposition criminalisée, la guerre normalisée ;
- en Chine, où l’obsession de la stabilité sociale écrase tout embryon de dissidence ;
- en Inde, où démocratie formelle et répression communautaire coexistent sous un même drapeau.
Et en Europe ? Elle vacille. Entre dérives sécuritaires, lois d’exception permanentes, montée des extrêmes et renoncements moraux face aux tragédies migratoires, la tentation autoritaire s’installe là aussi, insidieuse mais réelle.
Quant aux pays du Sud global, certains n’ont même plus besoin de prétexte : l’arbitraire est structurel, l’État de droit n’a jamais été installé ou a été méthodiquement démantelé. Les élites gouvernent par réflexe, sans recours, sans contre-pouvoirs, et parfois sans même feindre de justifier leurs décisions.
Mais ce qui différencie ces régimes dans l’exercice autoritaire, c’est d’abord la portée de leur impact. Une décision prise à Pékin, Moscou ou Washington peut bouleverser l’économie mondiale, déclencher un conflit ou étouffer une liberté à l’autre bout du globe. L’autoritarisme des puissants est extralocalisé, contagieux, parfois même codifié — traité, norme, algorithme, embargo.
Et pourtant, une nuance subsiste. Dans certains pays occidentaux, les contre-pouvoirs n’ont pas entièrement disparu. La justice, parfois, résiste. Les médias, parfois, dénoncent. Les citoyens, parfois, se mobilisent. Les institutions internationales, souvent timides, émettent encore des rappels à l’ordre, même si leur crédibilité s’effrite.
C’est peut-être là que réside la seule lueur : dans la possibilité du sursaut. Dans la faculté de dire non. Dans la capacité de réparer, de contester, de faire retour sur l’erreur.
C’est pourquoi il ne suffit plus de défendre la démocratie comme un idéal. Il faut la penser autrement. Non comme un régime parfait, mais comme un espace du possible. Un lieu où l’erreur du pouvoir est réversible, où le citoyen n’est pas un obstacle, où la loi n’est pas une épée, et où “nécessité fait loi” n’est plus un blanc-seing.
Une démocratie qui reconnaît ses failles, mais qui refuse de faire de l’urgence une tyrannie. Une démocratie réparatrice. Parce que c’est le seul endroit où l’humain peut encore être plus qu’un exécutant.
Conclusion : Rester debout quand tout pousse à plier
Ce texte n’est pas une plainte. C’est un constat. Et une alerte. Nous entrons dans un monde où gouverner ne signifie plus convaincre, mais contraindre. Où l’urgence est invoquée comme un absolu. Où la parole est contrôlée. Où le désaccord est pathologisé. Et partout, dans les discours comme dans les actes, cette formule revient comme une incantation : “nécessité fait loi“.
Mais il faut oser poser la question brute : quelle société produit-on quand la nécessité devient permanente ? Quand chaque crise justifie un recul ? Quand chaque exception devient une règle ? Quand la peur du désordre autorise tous les ordres ? Je n’ai pas de réponse définitive. Mais j’ai une conviction : aucune société humaine ne peut se construire durablement sur la peur, la soumission et le silence. Et aucune dignité individuelle ne peut survivre longtemps dans un monde où contester est suspect. Il ne s’agit pas de revenir en arrière. Il s’agit de réinvestir l’idée que la démocratie est une vigilance, pas un confort. Une lutte continue, pas une institution figée. Un droit à l’erreur, pas un culte de l’infaillibilité. Une force qui se mesure à sa capacité à encaisser le non, pas à l’étouffer.
La démocratie n’est pas parfaite. Mais elle reste le seul régime où l’arbitraire peut être dénoncé, corrigé, dépassé. Et dans ce monde saturé de nécessités, elle seule peut encore faire en sorte que la loi ne soit pas l’ombre du pouvoir, mais la lumière du juste.
Slim Othmani, Avril 2025
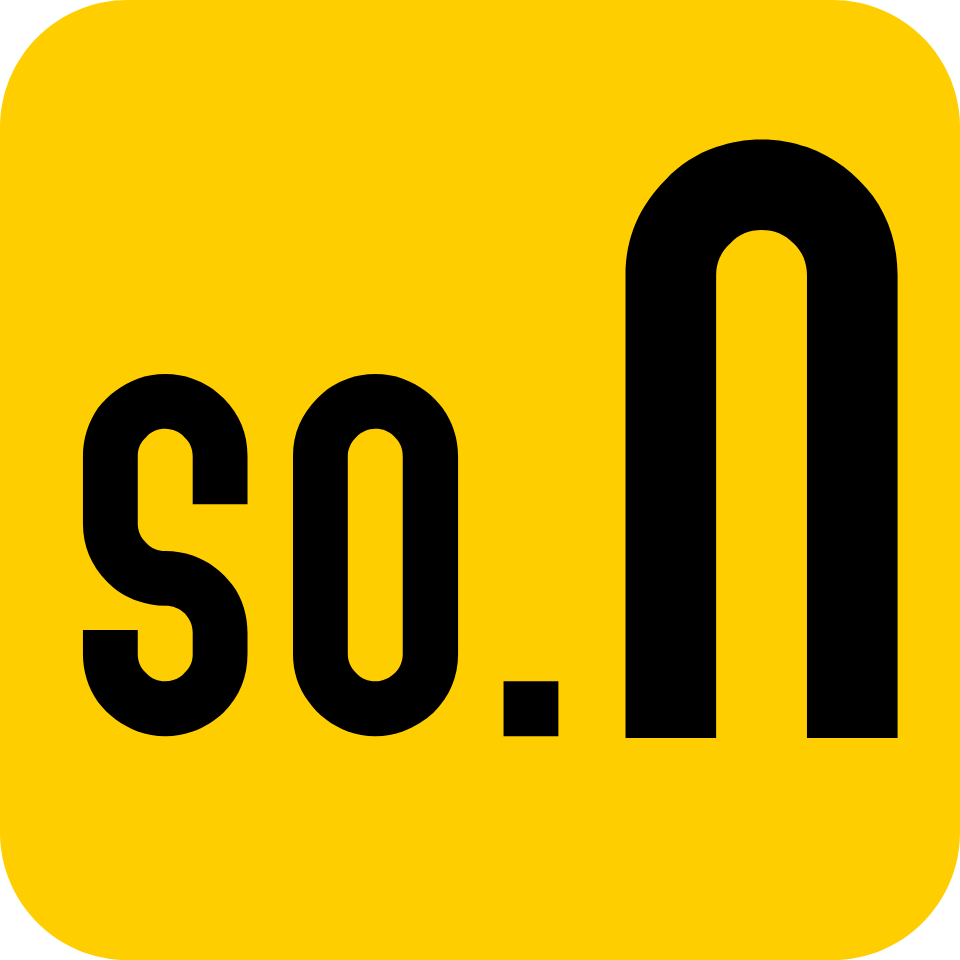
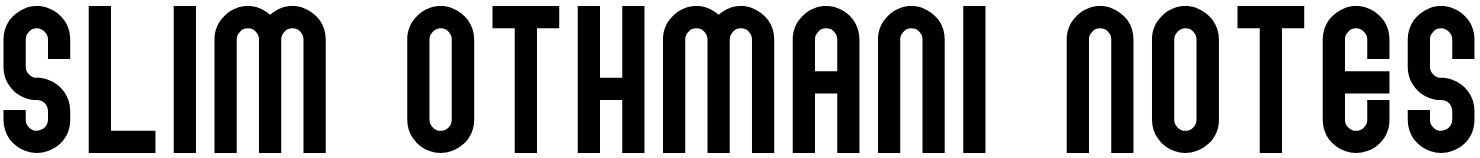

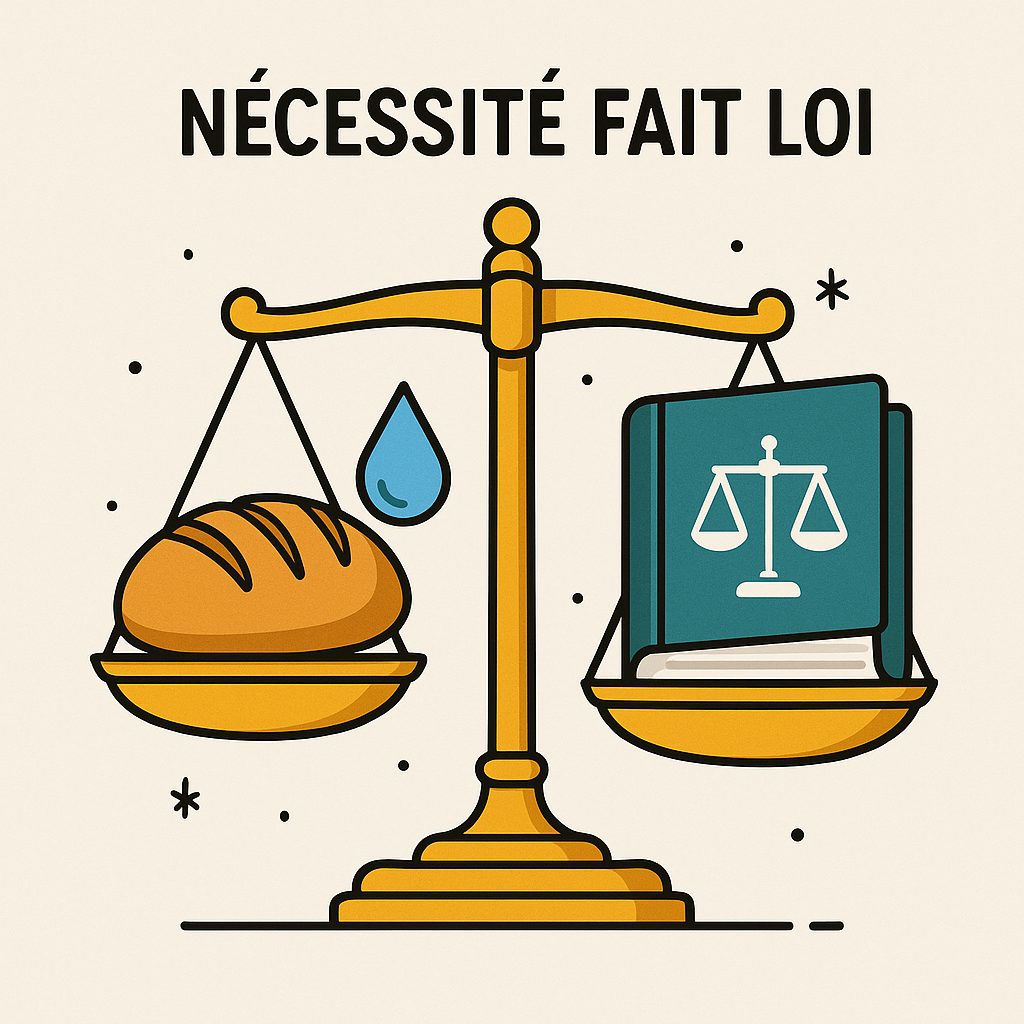




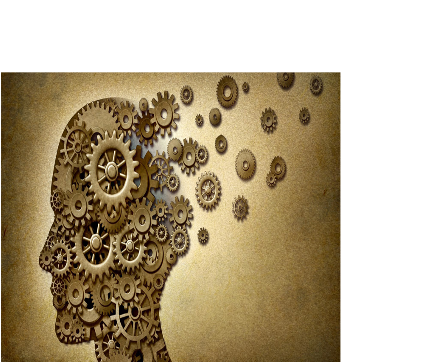
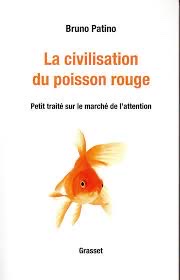



20 réponses
Merci Badis … cet publication je l’ai voulue comme une invitation, une interpellation, un éveil des consciences.À vous lire je pense avoir atteint ces objectifs, j’en suis sincèrement très heureux et honoré.
Cette réflexion incite à une reflexion, il l’aide en construisant un cadre moralement valide et sans excès. Il pose de belles questions en touchant des sujets majeurs qui transpirent en filigrane. Quelle est vraiment notre place ici et comment la reprendre en ne cessant pas de rester constructifs. Je retrouve dans ce texte les mêmes constats que je fais de plus en plus souvent, il semblerait que le monde prenne une direction où « le sens » semble avoir disparu, ou il n’est plus questions que de « postures », qu’on jette en pâture aux plus pressés d’entre nous. J’ai également aimé la conclusion qui ne ferme pas la porte a l’espoir, même si au regard de la qualité de la vision générale j’aurai beaucoup apprécié une conclusion aussi fournie. Je trouve ce texte juste, clairvoyant, et pourquoi pas, encourageant…
Merci
????
Merci Slim pour cette analyse dont je partage la conclusion.
Désormais nous assistons à un recul au niveau mondial de la justice au profit de la force.
Présentement celui qui est fort est juste et non pas celui qui est juste .
Merci d’avoir pris le temps de lire et commenter… et surtout pour la qualité de votre commentaire
Vivement des espaces …. merci pour votre commentaire
Très cher Anis ….. je suis content de savoir que tu lis mes articles et que tu sois conscient de la situation en Tunisie. Sois tout de même prudent car comme je l’ai écrit la servitude volontaire des affidiés au pouvoir est capable des pires arbitraires.
Merci
Merci Reyad …. c’est tout à fait exact
Tout à fait d’accord avec vous … merci
Merci
Merci
Très beau plaidoyer pour retrouver de vraies valeurs humanistes et universelles. Mission semblant difficile de prime abord, mais il y a de partout dans le monde des consciences prêtes à sursauter, j’en suis convaincue.
La phrase que je prèfère : “Et aucune dignité individuelle ne peut survivre longtemps dans un monde où contester est suspect”.
Merci
Bravo
La démocratie demeure toujours l’espace de renonciation et de lutte au coût le moins élevé et aussi l’espace de négociation le plus efficace
Slim,
Ton texte m’a profondément marqué. Tu as réussi à poser des mots sur cette dérive qu’on ressent mais qu’on n’arrive pas toujours à formuler. L’arbitraire est partout, insidieux, et ce consentement silencieux devient presque une norme. Mais ta lucidité fait la différence, elle nous pousse à ne pas accepter cette fatalité.
Il ne s’agit pas seulement de dénoncer, mais aussi de résister, de protéger ce qui reste d’espace libre : l’intelligence, la dignité, et la capacité à dire non.
Merci pour tes mots, ils nous rappellent l’importance de rester debout, même quand tout pousse à nous faire tomber.
Amicalement,
En somme nous nous auto censurons en se créant un état d’urgence virtuel qui nous bloque à jamais !
L obligatoire devient notre unique nécessité. On y répond tant bien que mal, pour le moins anars, et tant pus pour le reste.
Toute nouvelle initiative est tuée dans l œuf. Nous vivons du minimum syndical
Et on ne peut se le reprocher qu à soi même. Pour les plus avertis.
Bravo Slim. C’est limpide, tout est dît.
Mais même les democraties peuvent devenir un terreau favorable au “nécessité fait loi” le DOGE de Musk en est l’exemple parfait, ou encore Trump qui a érigé le contradictoire en anti-patriote/ennemi/fake news, etc…
Constat parfait et surtout très bien écrit ! Ce pamphlet bat en brèche la distinction que font les occidentaux entre leurs démocraties qu’ils veulent exporter et imposer sans tenir des spécificités socioculturelles des pays cibles et certaines démocraties de façade où l’expression de la majorité est bafouée bien que des élections se tiennent…..
Magistral!
Très beau texte !