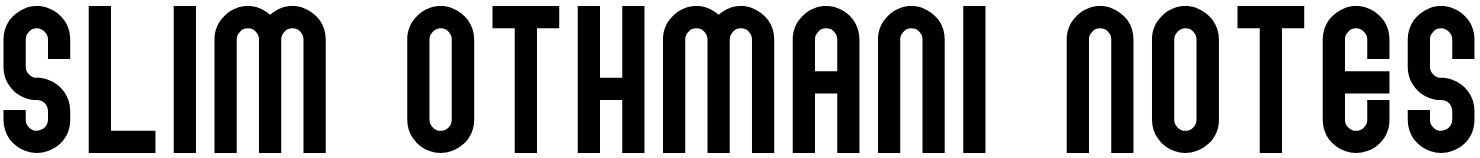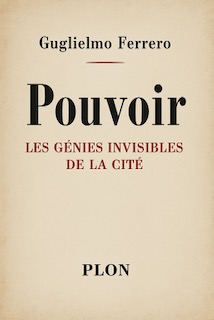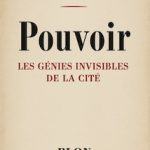C’est l’annonce, cette semaine, de la parution du livre On Power de Mark R. Levin qui m’a remis en mémoire un ouvrage autrement plus ancien, mais dont la puissance analytique reste intacte : “Pouvoir – Les Génies invisibles de la Cité” de Guglielmo Ferrero, publié en 1942.
Dans un monde saturé de récits sur la conquête, la gestion et la perte du pouvoir, il m’a semblé salutaire de revenir à ce texte fondateur, dont la portée philosophique et politique dépasse les circonstances de sa publication.
J’avais longtemps cherché un ouvrage capable de donner du sens à l’histoire du pouvoir, non pas comme une simple mécanique institutionnelle, mais comme une force presque métaphysique, invisible, à la fois fascinante et destructrice. Ferrero m’avais offert cette lecture rare, lumineuse.
Ce que je vous propose ici, c’est une tentative de relier les intuitions de Ferrero aux formes que prend le pouvoir aujourd’hui : plus insaisissable, plus éclaté, plus technologique aussi, mais toujours aussi avide de légitimité. Guglielmo Ferrero cherchait à répondre à une question apparemment simple : pourquoi obéit-on ? Il écarte d’emblée la peur ou l’habitude comme fondements durables du pouvoir. Pour lui ce qui fonde l’obéissance durable, c’est la légitimité. Et ce qu’elle soit politique, entrepreneuriale ou même familiale.
Il identifie quatre formes principales de légitimité :
- Divine : le pouvoir vient des dieux, d’un ordre surnaturel (rois sacrés, théocraties).
- Dynastique : le pouvoir est transmis par le sang, dans une continuité historique acceptée. (monarchies, descendance familiale)
- Révolutionnaire : le pouvoir surgit de la rupture, de l’émancipation, et se légitime par le projet de justice.
- Légale-rationnelle : propre aux régimes modernes, il se fonde sur le droit, la procédure, le contrat social, les urnes.
Ferrero n’oppose pas ces formes, il les observe comme des cycles historiques, chacune répondant à une crise de la précédente. Et chacune étant, tôt ou tard, confrontée à l’usure de sa propre légitimité.
Aujourd’hui, sans que nous nous en rendions vraiment compte, nous vivons dans un monde où ces formes de légitimité coexistent, s’affrontent, se parasitent. Ferrero aurait sans doute parlé de dissonance politique : le roi parle au nom de Dieu, mais gouverne avec Excel. Le président se veut révolutionnaire, mais gouverne par décret. Le PDG n’est ni élu ni couronné, mais détient le pouvoir d’orienter les modes de vie de millions d’individus par ses produits.
Ce flou contemporain sur la source du pouvoir crée une incertitude profonde. Quand on ne sait plus d’où vient le pouvoir, on ne sait plus à quoi il sert, ni comment le contester. C’est dans ce contexte que trois mutations majeures méritent d’être mises en lumière : le pouvoir technologique, le pouvoir en entreprise, et l’ambiguïté de la démocratie contemporaine.
À l’ère numérique, le pouvoir ne siège plus dans des palais ni même dans des parlements. Il s’insinue dans les algorithmes, les architectures numériques, les plateformes globales. Ces entités – Apple, Google, Meta, TikTok, Palantir – dictent nos accès à l’information, nos comportements, nos désirs. Leur légitimité n’est ni divine, ni électorale, ni révolutionnaire. Elle est technicienne. On leur obéit parce qu’elles fonctionnent, parce qu’elles séduisent, parce qu’elles s’imposent. Mais pour Ferrero, tout pouvoir sans justification morale, sans récit fondateur, sans limitation externe, est en germe tyrannique. C’est pourquoi la crise actuelle de la souveraineté n’est pas juridique. Elle est légitimiste : qui nous gouverne vraiment, et selon quelle autorité ? Une vraie question soumise à débat.
Le pouvoir en entreprise n’est plus une affaire de hiérarchie militaire. Il est devenu narratif, réputationnel, affectif. On attend du dirigeant qu’il soit à la fois stratège, éthique, inspirant, inclusif. Le pouvoir économique ne se contente plus de produire, il doit aussi “signifier”. Mais lorsque cette quête de sens se dissout dans le cynisme, ou que les slogans d’engagement masquent une gouvernance sans partage, le pouvoir entrepreneurial perd sa légitimité. Il devient autoritaire sous couvert de bienveillance. Ferrero dirait qu’il redevient païen : soumis aux caprices des “génies” internes, des oracles d’audience ou d’actionnariat.
Le plus troublant reste peut-être ce paradoxe : la démocratie moderne peut, à force d’excès, devenir un instrument d’oppression. Non plus une tyrannie de l’État, mais une tyrannie sociale, médiatique, numérique :
- La tyrannie de la majorité contre les singularités.
- La tyrannie du commentaire contre la complexité.
- La tyrannie de la transparence, qui transforme le débat en surveillance.
- La tyrannie de la vitesse, qui tue la réflexion et sacralise la réaction.
Ferrero, en prophète discret, nous avertissait déjà : la démocratie sans légitimité devient une caricature d’elle-même. Ce n’est pas la fin du pouvoir, c’est sa décomposition dans l’apparence du consensus.
Pour conclure cet exercice de relecture, je ne peux que constater que nous sommes dans un monde où le pouvoir est partout, mais la légitimité nulle part. Où l’autorité se disperse, mais l’obéissance demeure. Où les récits de légitimation s’usent plus vite qu’ils ne se renouvellent. Finalement relire Ferrero, ce n’est pas chercher une solution clé en main. C’est réapprendre à poser la bonne question : qu’est-ce qui rend le pouvoir acceptable, aujourd’hui ? Sans cette interrogation radicale, nous ne ferons que courir après les simulacres.
Et comme l’écrit Ferrero dans une phrase qui résonne comme une gifle douce : « Le pouvoir, pour durer, doit inspirer autre chose que la peur. Il doit faire naître l’espérance. »