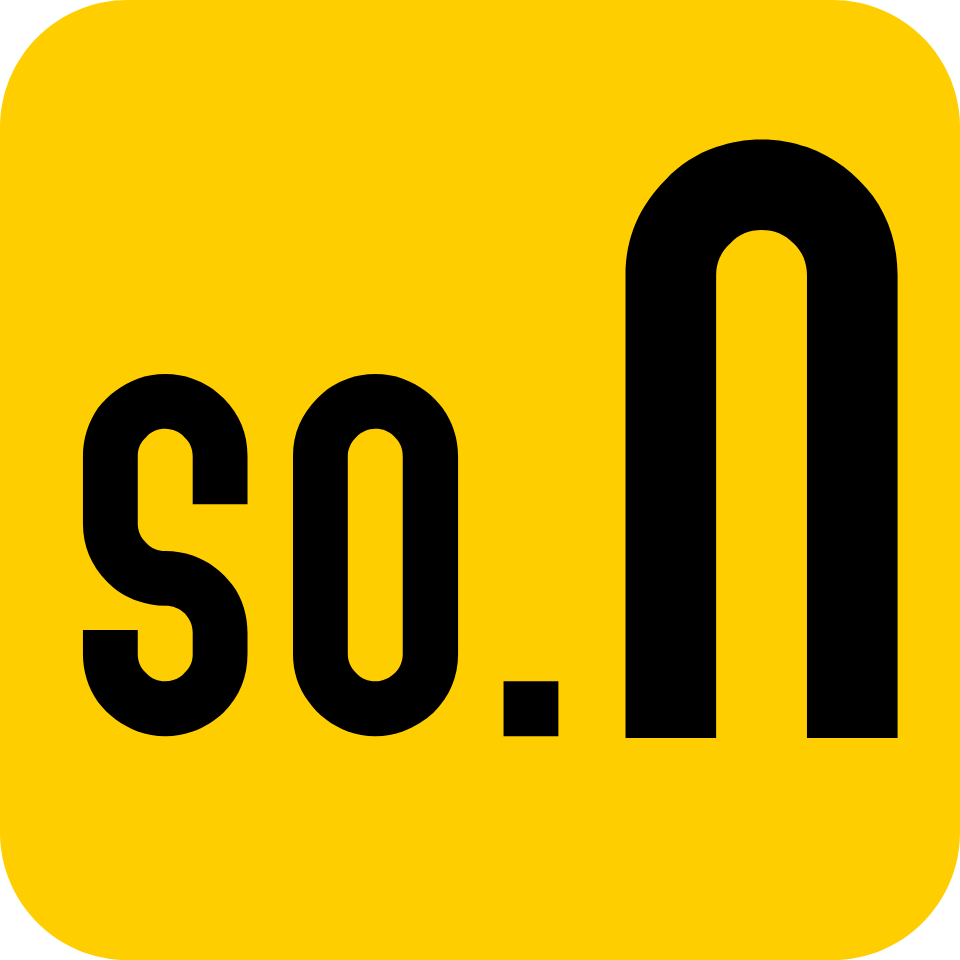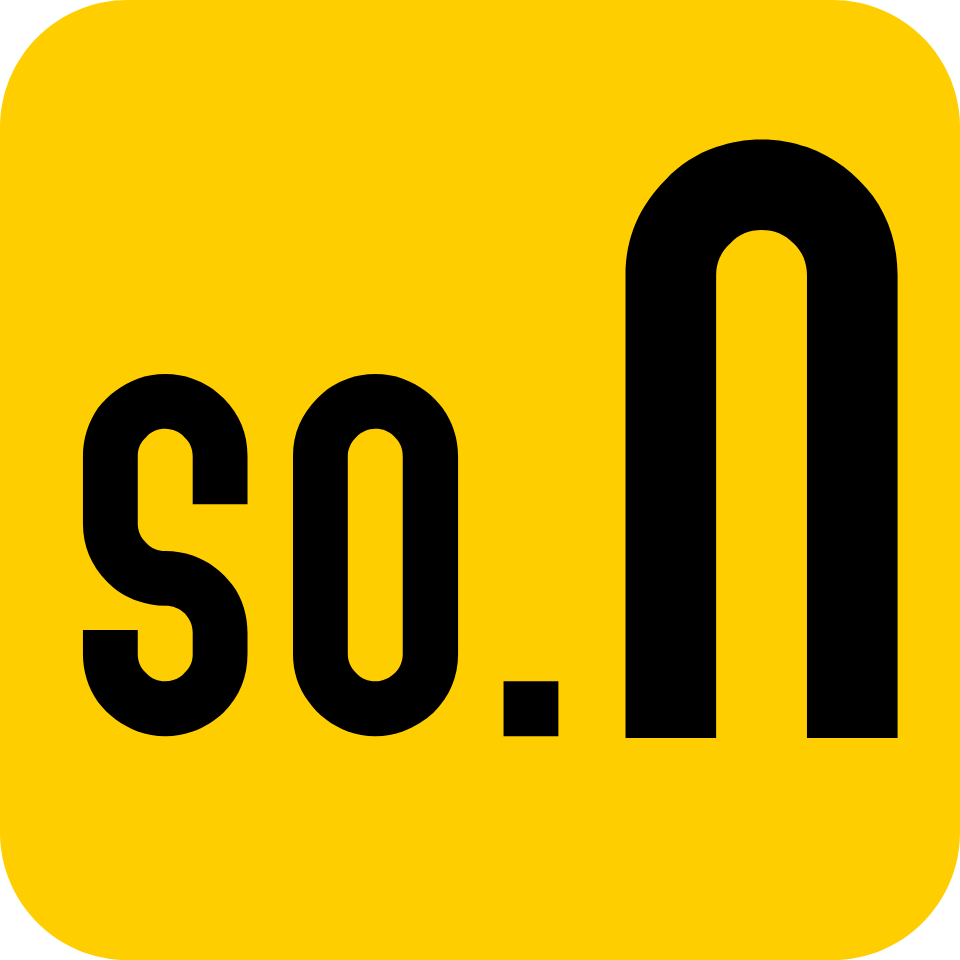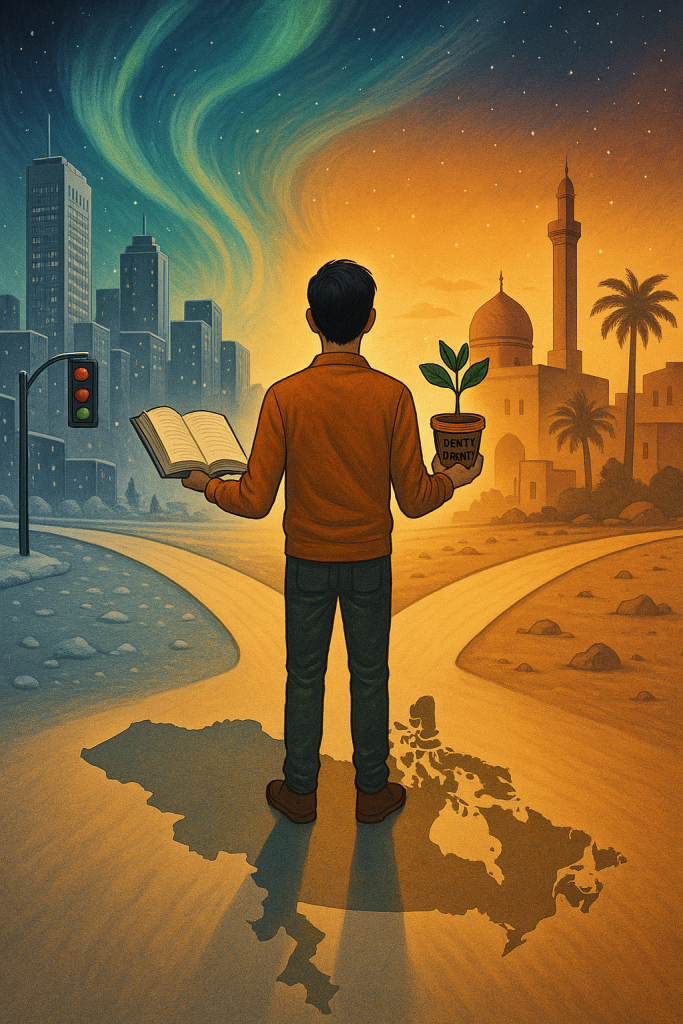McGill University Montreal , Mai 2025
C’est toujours un moment particulier que de prendre la parole devant une jeunesse en quête de sens, entre deux mondes, entre deux langues, entre deux cultures, entre deux fidélités. Ce que vous appelez parfois un dilemme identitaire, je le vois moi comme ...