« Ce murmure permanent, cette parole avalée, n’est-elle pas le signe d’un monde qui ne sait plus comment dire ? »
L’étrange montée des voix nasillardes : simple impression ou phénomène global ?
J’ai l’impression que les voix humaines changent. Pas seulement d’un pays à l’autre ou d’une langue à l’autre, mais partout : elles semblent de plus en plus nasillardes. Comme si le monde entier parlait du nez, ou à travers un filtre qui pince le souffle. Cette sensation, je l’ai éprouvée sans vraiment y prêter attention. Et puis, à force d’écouter — radios, podcasts, conversations publiques ou privées — elle s’est imposée comme une évidence.
Alors, me suis-je dit, est-ce le fruit d’une illusion sonore, d’un biais perceptif ? Ou bien sommes-nous témoins, sans le savoir, d’une mutation subtile mais significative du timbre humain ?
Il ne s’agit pas ici d’une démonstration scientifique mais d’une interrogation nourrie par l’observation, que j’essaie de structurer. Et plus j’y réfléchis, plus les indices se multiplient.
Hypothèses d’explication ?
D’abord, les styles vocaux ont changé. Les réseaux sociaux ont introduit une parole en boucle, mimétique, normalisée. Certains timbres deviennent viraux, au sens propre. L’intonation nasale, comme le “vocal fry” dans les cultures anglo-saxonnes, s’installe comme un style – parfois jugé jeune, branché, ou décontracté. Le micro de téléphone portable, compressé, ne fait rien pour arranger les choses.
Ensuite, il y a la physiologie contemporaine. Des respirations superficielles, une sédentarité généralisée, une mâchoire moins sollicitée par des aliments trop mous, des allergies urbaines chroniques : tout cela joue contre la richesse vibratoire de la voix.
Et si cela allait plus loin ?
La première touche à notre état psychologique collectif. Une humanité fatiguée, anxieuse, enfermée dans un monde bavard mais peu écouté, pourrait naturellement produire des voix qui ne viennent plus du ventre, ni du cœur, mais du haut du nez. La voix nasillarde serait-elle le symptôme d’un mal de vivre généralisé, comme une parole coupée de ses appuis profonds ? Une voix étriquée pour des existences contractées ?
La seconde relève de l’alimentation moderne. De plus en plus d’études suggèrent que nos mâchoires s’atrophient, que nos palais deviennent plus étroits, que nos sinus se ferment. Non seulement parce que nous mâchons moins, mais aussi parce que notre microbiote se déséquilibre. Le lien entre alimentation, respiration, posture et voix n’est pas anodin. Et si nos voix trahissaient le délitement silencieux de nos équilibres intérieurs ?
Un vécu auditif personnel ?
Mais cette réflexion ne vient pas de nulle part. Deux événements ont marqué ma propre relation au son — ou plutôt mon vécu auditif. Le premier, brutal, a eu lieu lors d’une soirée de mariage. Assis trop près d’une enceinte, j’ai été victime d’un accident sonore : l’ingénieur du son, par mégarde, a poussé le volume à son maximum. Un choc. Une perte auditive temporaire qui a duré plusieurs jours. Un voile sur le monde.
Quelques années plus tard, nouveau traumatisme. À la suite d’une infection au Covid, une surdité soudaine s’est déclarée. Discrète mais sournoise. Depuis, alors que j’avais toujours eu une oreille musicale particulièrement fine, je suis devenu attentif — parfois trop — au moindre timbre, à la moindre dissonance. Et ce que j’entends me trouble.
J’ai l’impression que les humains n’articulent plus. Que dans tous les films, quels que soient le drame ou l’action, les acteurs chuchotent. Comme si l’époque avait peur d’élever la voix. Comme si les dialogues étaient devenus des soupirs codés, privés de chair et d’élan.
Voix rauques et symbolique du pouvoir ?
Enfin, une dernière piste, presque anthropologique : la disparition progressive des voix rauques. Ces voix graves, légèrement éraillées, symbolisent souvent l’autorité, la virilité, la puissance. Or, dans un monde où l’agressivité se déplace du physique vers le symbolique ou le numérique, où les rapports virils sont moins assumés, la voix rauque recule, remplacée par un timbre plus aigu, plus nerveux, moins enraciné. Que perdons-nous dans cette transformation vocale ? Peut-être une part de force, ou peut-être tout simplement une autre manière d’habiter le monde.
Slim Othmani, août 2025
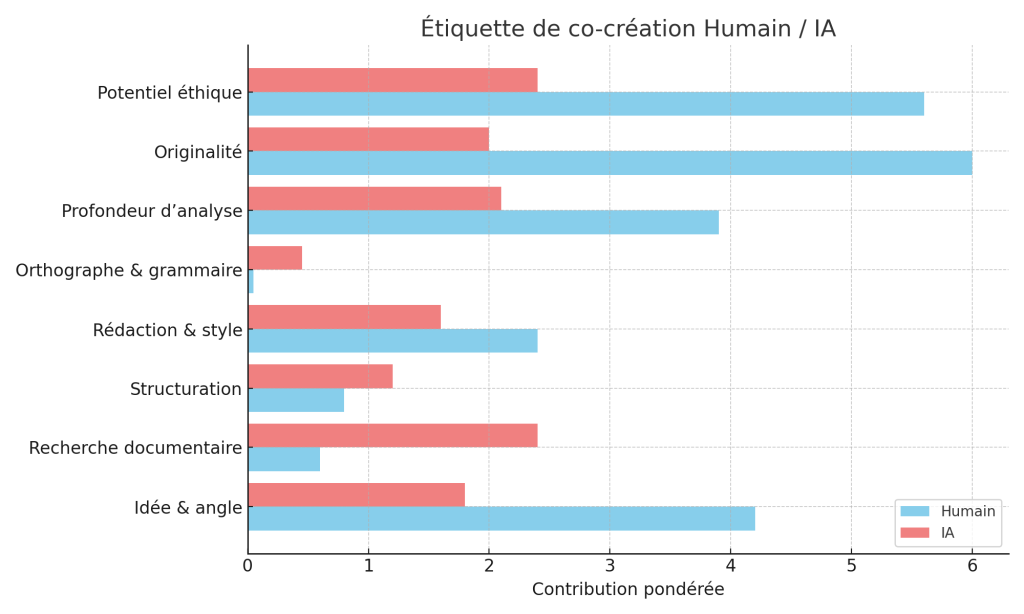
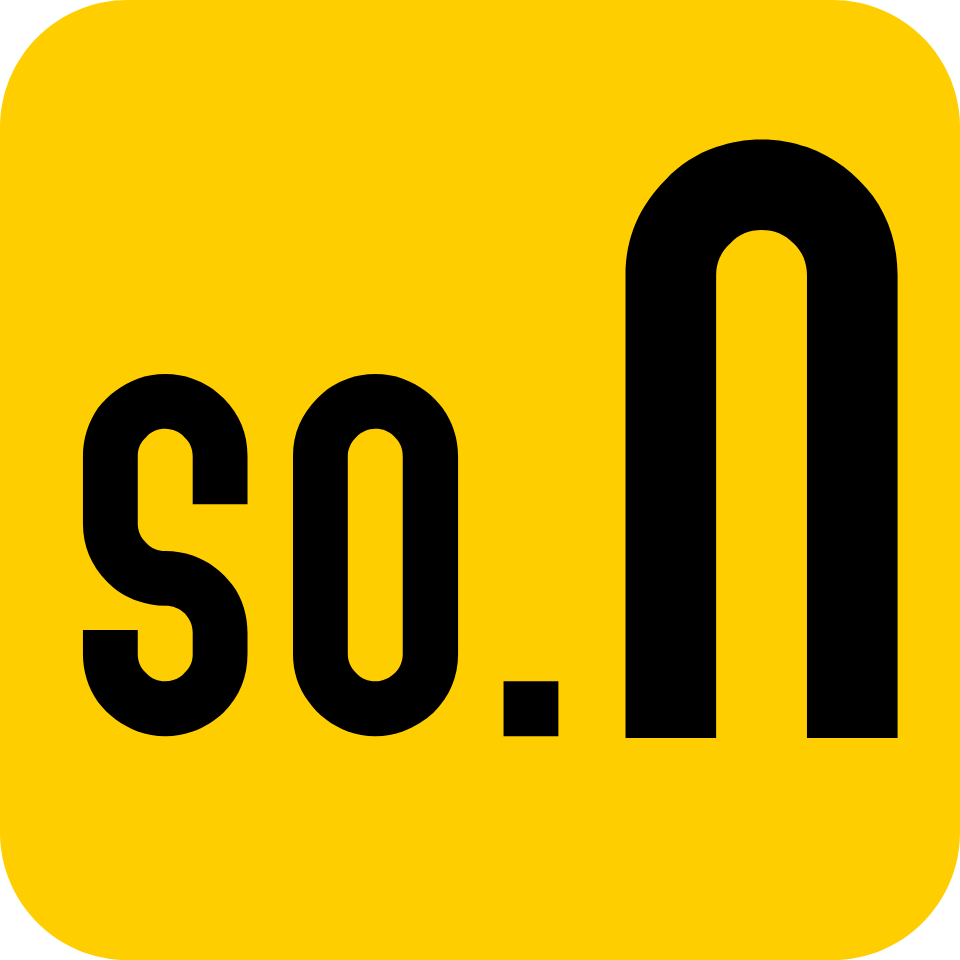
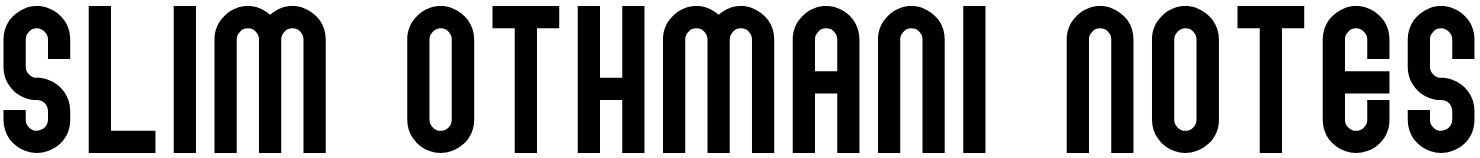









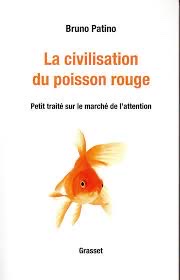

3 réponses
Merci Rachid ….. j’ai rendu visite à une fromagerie ou il m’arrive souent d’acheter des fromages (dans le sud de la france) j’ai parlé de tes recherches qui les ont fortement intéressé …. a très vite
C’est intéressant de constater que tu perçois une généralisation du phénomène. J’ai moi-même constaté, dans un autre registre, un changement dans la façon de chanter, où nous sommes envahis de murmures et de chuchotements souvent insipides sans parler de l’horrible effet de l’auto-tune.
Tu me diras : à l’ère des réseaux sociaux, pas besoin d’un talent particulier pour avoir de la notoriété. Dois t’on maitriser le figuratif si on fait de l’abstrait? Hahaha!
Mais un fait plus inquiétant m’avait interpellée récemment. J’étais tombée sur une publication sur Instagram faisant référence à une étude publiée dans un journal scientifique très sérieux. Elle rapportait que les jeunes de 20 ans aujourd’hui avaient un niveau de testostérone équivalent à celui d’un homme de 70 ans dans les années 1970. Je ne te raconte pas ce que j’ai pu recevoir réactions en MP après l’avoir partagé sur une story!
Le timbre grave se raréfie chez les jeunes hommes, et je l’avais bien remarqué également. A ce rythme là, bientôt les graves seront classés comme patrimoine immatériel de l’humanité 🙂
Merci pour cette analyse tridimensionnelle de la voix .
Cette approche de comprendre les mutations de la société a travers le timbre de la voix et non seulement intrigante mais je pense même l’intelligence artificielle n’arrive pas comprendre.
Merci encore pour ces précieuses vibrations et au plaisir a d’autres émotions.
Cordialement